Claude Quétel, ancien directeur du mémorial de Caen, propose en 2014 cette synthèse sur le fameux docteur Marcel Petiot. On passera sur le fait que la collection Points Crime du Seuil était dirigée par Stéphane Bourgoin, dont la légitimité scientifique a été sérieusement écornée.
Paradoxalement, comme le rappelle l'auteur en introduction, si Petiot a fait l'objet d'une abondante littérature, si son histoire a été adaptée en bandes dessinées et même au cinéma en 1990 avec Michel Serrault dans le rôle titre, peu d'analyses se sont penchées sur la question de la folie de Petiot, qui apparaît pourtant assez tôt dans sa vie. Claude Quétel cherche aussi à replacer les crimes de Petiot sur le temps long, en brossant un portrait complet du personnage, de sa naissance à son exécution le 25 mai 1946.
Petiot est né à Auxerre en 1897. C'est le fils d'un fonctionnaire des Postes. Son frère Maurice naît en 1906. A la mort de sa mère, son père part s'installer à Joigny. La scolarité de Marcel Petiot est agitée. Il se fait remarquer par des écarts de comportement et il est renvoyé du collège de Joigny. Revenu à Auxerre, il est arrêté par la police, en 1914, quelques mois avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, pour avoir fracturé des boîtes aux lettres et ouvert le courrier qui s'y trouvait. Les rapports psychiatriques précisent déjà toute l'instabilité de son caractère, mais il bénéficie d'un non-lieu.
Petiot s'engage ensuite dans des études de médecine. En janvier 1916, il devance la mobilisation de sa classe d'âge (1917) et s'engage dans l'armée. Il reste 5 mois sur le front en 1917 et se retrouve sur le chemin des Dames. Il est blessé au pied par un éclat de grenade. Il finit dans une prison militaire à Orléans en 1918, après s'être enfui. On lui reconnaît une pension d'invalidité pour "maladie mentale". Il poursuit néanmoins ses études de médecine qu'il termine en décembre 1921. Se pose alors la question de savoir si, oui ou non, Petiot a simulé la folie devant les médecins militaires - ceux-ci étant, sinon, particulièrement incapables de discerner la vraie nature du personnage. A moins qu'à force de jouer au fou, il ne le soit devenu...
En 1922, il s'installe à Villeneuve-sur-Yonne, non loin des lieux de son enfance. Ses manières de médecin brusquent et séduisent à la fois les habitants : on dirait aujourd'hui que Petiot est un "bon communicant", même s'il vire dans la mythomanie en s'attribuant des titres qu'il n'a pas. Petiot s'engage en politique à gauche, dès 1925, tant est si bien qu'il finit par remplacer l'ancien maire, son mentor, en 1926. Le nouveau maire suscite néanmoins l'inquiétude chez certains. Il a la manie de tenir lui-même les compte-rendus des conseils municipaux et à la désagréable habitude d'être cleptomane. Ce qui ne l'empêche pas d'être réélu. En 1927, il épouse Georgette, Icaunaise de Seignelay et fille d'un restaurateur installé près de l'Assemblée Nationale. Petiot, qui a conçu des projets pharaoniques pour la petite ville, l'endettant lourdement, intéresse bientôt la police : il s'empare pour sa personne d'objets trouvés déposés à la mairie. Le préfet et le ministère de l'Intérieur, renseignés sur son passé psychiatrique, cherchent la moindre occasion de le débarquer, ce qui se présente en 1931 en raison de la gestion financière calamiteuse et malhonnête de la commune. Petiot prend alors la décision de s'installer à Paris. Mais en 1932, il est encore rattrapé par la justice et condamné pour branchement illégal d'électricité. Le syndicat des médecins de l'Yonne a refusé de le compter parmi ses membres, alors qu'on sait qu'il falsifie des documents médicaux pour certaines consultations. En outre, on ne sait pas ce qu'est devenue sa bonne Louisette, engagée en 1924, et qui disparu. En 1930, une coopérative laitière voisine de Villeneuve brûle avec à l'intérieur le corps de la femme du gérant, et une forte somme d'argent a disparu. Rien ne relie Petiot précisément à ses faits divers, mais les soupçons demeurent. La police sait toutefois à quoi s'en tenir sur le personnage.
Installé rue Caumartin, à Paris, Petiot reprend la même stratégie qu'à Villeneuve-sur-Yonne : distribution de prospectus, mythomanie et titres ronflants, mais il est joignable facilement au téléphone et se déplace chez ses patients en pratiquant des tarifs modiques pour l'époque. Mais dès novembre 1934, Petiot est impliqué dans une affaire de stupéfiants : il fournit en morphine des toxicomanes avec des ordonnances de complaisance. Les enquêtes de voisinage lui sont pourtant favorables. Petiot se montre également à Paris un chineur compulsif, détail qui aura son importance au vu de son parcours macabre ensuite.
En avril 1936, Petiot subtilise un livre dans la librairie Gibert et se fait arrêter par un vigile. On le place en maison de santé au vu des diagnostics psychiatriques, qui concluent déjà au caractère retors et fourbe du personnage : Petiot est soupçonné d'avoir provoqué au moins un décès par des injections de produit mal dosé. Il est libéré en février 1937 mais personne ne s'inquiète de le voir encore exercer la médecine.
Gagnant 500 000 francs par an et dépensant peu, Petiot entasse les objets achetés à l'hôtel des ventes Drouot. Il achète un immeuble rue de Reuilly et une maison à Auxerre. Sa spécialité reste le monde interlope des toxicomanes, qu'il n'a aucun problème à fréquenter. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas mobilisable. Pendant la débâcle, on le nomme même médecin de l'état civil du 9ème arrondissement, pour procéder aux inhumations... sous l'Occupation, Petiot transporte ses achats en vélo, tirant une remorque. Spectacle classique de l'époque. En août 1941, il fait l'acquisition d'un hôtel particulier délabré rue Lesueur, qu'il fait aménager pour isoler la cour des voisins et aménager dans celle-ci un faux cabinet de consultation et une étrange pièce de forme triangulaire, censée servir à des traitements d'électrothérapie. La première victime de Petiot sera Joachim Guschinow, un fourreur juif polonais qui habite à côté de chez lui et qui veut quitter la France, effrayé par la législation antisémite de Vichy. Petiot lui assure qu'il peut lui faire quitter la France, monnayant finance. Guschinow part en janvier 1942 pour ce qu'il croit être l'Argentine, mais on ne reverra plus. Petiot montre pourtant à sa femme une lettre écrite de sa main. En février 1942, Petiot se débarrasse de Jean-Marie Van Bever, amant d'une toxicomane à laquelle Petiot fournissait des ordonnances de complaisance à son nom, et qui avait attiré l'attention de la police. En mars 1942, c'est Marthe Khayt, mère d'une toxicomane à laquelle Petiot avait fourni des ordonnances à son nom, qui disparaît aussi. Petiot est jugé pour ces deux affaires, mais faute de preuves, et grâce à la défense de René Floriot, il écope simplement d'amendes. Disparue aussi, Nelly Hotin, épouse d'un gros cultivateur de l'Oise venue se faire avorter à Paris, et qu'on ne reverra plus après sa rencontre avec Petiot le 5 juin 1942. Ce même mois, Petiot s'occupe du "voyage" du docteur juif Braunberger, qui ne donnera plus signe de vie. Le bon docteur raffine son système en engageant des rabatteurs qui vont écumer les bars interlopes : Charles Fourrier et Edmond Pintard. Leurs premières victimes seront les Kneller, des Juifs allemands réfugiés en France avec un enfant, qui ont échappé à la rafle du Vel' d'Hiv grâce à l'aide d'une voisine. Petiot s'occupe d'abord du père, puis de la mère et du fils. Petiot s'occupe également de criminels de droit commun : Joseph Réocreux et François Albertini, qui viennent de réussir un casse en se faisant passer pour la Gestapo, veulent quitter la France avec leurs maîtresses, et qui disparaissent en août 1942. En mars 1943, deux autres criminels, Joseph Piereschi et Adrien Estébétéguy, prennent aussi la "filière" du bon docteur Eugène, surnom que s'est donné Petiot pour ses crimes crapuleux. Entretemps, Fourrier a présenté à Petiot une nouvelle rabatteuse : Eryane Kahan, Juive roumaine au passé d'infirmière douteux. En décembre 1942, grâce à elle, Petiot se débarrasse des Wolff, réfugiés juifs antinazis : le mari, sa mère, et sa femme, puis des Basch, venus de Hollande, chacun avec leurs deux parents. Certains sont toutefois plus méfiants : les époux Cadoret, dont la femme est juive, effrayés par Petiot, renoncent. Petiot continue en parallèle son activité de médecin, mais se fait remarquer par des vols à domicile lorsqu'il officie comme médecin d'état civil.
Petiot commence toutefois à attirer l'attention de la Gestapo, installée rue des Saussaies à Paris, à la fois du service 131 de Jodkum, chargé des questions juives, et de la section 530 de Berger, chargé de la sécurité des troupes allemandes. Jodkum, qui a repéré Fourrier, se sert d'un prisonnier juif, Yvan Dreyfus, sorti du camp de Compiègne où il était enfermé pour avoir essayé de rallier l'Angleterre, afin d'infiltrer la filière du docteur Eugène. Les nazis pensent que ce docteur, dont ils ignorent encore l'identité, procède à des transferts de Juifs en étant aidé par une ambassade étrangère. Dreyfus est malgré tout liquidé par Petiot. La Gestapo arrête alors Fourrier, qui donne l'identité de Petiot. Les deux sont expédiés à la prison de Fresnes. La Gestapo ne connaît pas l'hôtel de la rue Lesueur et ne le fouille donc pas. Petiot, torturé, ne dit rien de ce qu'il a fait des Juifs qu'il a emmenés. La Gestapo le relâche en janvier 1944, après 7 mois de prison, et après avoir reçu 100 00 francs de son frère Maurice.
Maurice Petiot a emmené sur ordre de son frère 400 kg de chaux à l'hôtel de la rue Lesueur en février 1944. Le 11 mars, un habitant de la rue appelle les pompiers : une fumée noire et nauséabonde sort de la cheminée du 21. Quand les pompiers forcent l'entrée pour éteindre ce qu'ils croient être un feu, ils découvrent des débris humains dans la cave et un four brûlant rempli de restes humains en train de se consumer. Petiot surgit en vélo sur les lieux et, sans donner son identité, explique aux agents de police qu'il s'agit de collaborateurs tués par la Résitance. Puis il prend la fuite. Le commissaire Massu, l'as de la criminelle qui inspire le personnage de Maigret à Simenon, enrage quand il apprend la chose, car il comprend que Petiot s'est maintenant envolé. Dans l'hôtel, outre des corps ravagés par la chaux, les policiers trouvent un puits rempli d'autres débris humains, et la mystérieuse installation du faux cabinet de la pièce triangulaire.
La chasse au Petiot commence alors. La police fait chou blanc chez le frère, Maurice. La presse et la radio collaborationnistes se déchaînent, faisant de Petiot un nouveau Landru, inféodé à De Gaulle et à Staline. On fait la comparaison entre le 21, rue Lesueur, et le film L'assassin habite au 21 de Clouzot, encore dans les salles à l'époque. Massu a fait arrêter Georgette, la femme, et Maurice, le frère. Le rôle de ce dernier est plus que trouble. En plus d'avoir apporté la chaux, il nie avoir vu à l'hôtel tous les objets entassés par son frère. C'est probablement lui qui a organisé le départ de biens des décédés vers l'Yonne, à Courson et Seignelay, où les policiers les retrouvent. Fourrier et Pintard sont également arrêtés. La méthode d'exécution reste floue : on pense que Petiot injectait sous prétexte de vaccins des solutions létales à ses victimes, ou qu'il les gazait dans la pièce triangulaire, à moins qu'une seringue activée depuis l'extérieur n'ait abattu les prisonniers dans celle-ci...
Petiot s'est caché à Paris, chez un peintre en bâtiment, Georges Redouté. Il profite de la Libération pour réapparaître au grand jour, jouant au résistant. Avec le pseudonyme de Valéri, il subtilise à la mère d'un médecin prisonnier de guerre, Wetterwald, les papiers d'identité de ce dernier, puis s'engage dans le 1er régiment de marche de Paris en septembre 1944, comme lieutenant du service de santé. Il reste à Paris à la caserne de Reuilly et rejoint la sécurité militaire. La presse de la Libération le voit quant à elle comme une créature des nazis, liée à la Gestapo. Petiot, dont l'humilité n'est pas la qualité première, répond de manière anonyme à la presse, ce qui confirme à la police qu'il est à Paris. C'est la sécurité militaire qui confond l'écriture du pseudo-capitaine Valéri et l'arrête le 31 octobre 1944. Devant son premier interrogateur, Petiot se prétend résistant, à la tête d'un mystérieux groupe "Fly-Tox" (!) que personne ne connaît de près ou de loin.
Petiot ne dévie pas de son système de défense. Le juge d'instruction a un dossier suffisamment solide pour faire passer le docteur en jugement, à partir de novembre 1945. Pour lui, Petiot a agi avant tout par appât du gain. Dans la cellule n°7 de la prison de la Santé, Petiot écrit un livre, Le Hasard vaincu, sur les jeux d'argent (!). L'instruction, quant à elle, se termine. Pas de corps entier, mais tout ce qui a été retrouvé à l'hôtel Lesueur, et les 59 valises envoyées dans l'Yonne, qui ne laissent guère de doute sur le sort de leurs propriétaires... pour le ministère public, Petiot a commis ses crimes par cupidité, en étant responsable de ses actes. On ne se demande pas trop comment il a réussi à faire écrire des lettres aux victimes, y compris les truands pourtant armés qu'il a éliminé. L'instruction se concentre sur Petiot et ne s'occupera pas des rabatteurs, ni de la femme, encore moins du frère, pourtant complice a minima. Le procès s'ouvre en mars 1946. Petiot y multiplie les coups d'éclat, provoquant, sans jamais rien avouer. Le déplacement rue Lesueur n'y change rien. Petiot est condamné à mort par le tribunal.
L'avocat de Petiot, Floriot, n'a même pas essayé de plaider la folie, ce qui est pour le moins étonnant. Le recours en grâce auprès du président est rejeté. Le 25 mai 1946, Petiot monte sur la guillotine. Sa dernière phrase à l'avocat général, restée dans les annales, est la suivante : "Je suis un voyageur qui emporte ses bagages.". Il est enterré au quartier des suppliciés du cimetière d'Ivry.
L'affaire Petiot recelè encore bien des mystères. Le magot de Petiot, considérable, n'a jamais été retrouvé, malgré des fouilles à l'hôtel Lesueur avant sa démolition dans les années 1950. Le fils de Petiot est parti en Amérique du Sud, mais avec quels moyens ? Sa mère le rejoindra. La postérité de l'affaire connaîtra des bandes dessinées, le film de Christian de Chalonge, en 1990, qui fait de Petiot un fou hystérique, n'assassinant que des Juifs, une sorte de miniature de la Shoah. Le cas Petiot divisait encore dans le Villeneuve-sur-Yonne des années 80. On a fait ensuite de Petiot le bras droit des Français de la Gestapo rue Lauriston, ou de la Résistance, plutôt communiste. Claude Quétel conclut sur l'analyse psychologique en citant notamment des experts d'avant et après la guerre : ce qui paraît anormal, c'est que Petiot ait traversé tant de procès et d'expertises sans être soigné à demeure et qu'on l'ait laissé pratiquer la médecine. En somme, ses crimes étaient évitables.
Le livre intéressera toute personne soucieuse d'en savoir plus sur Petiot. Toutefois, on ne comprend pas bien où l'auteur veut en venir avec son sous-titre : fou ou coupable. A aucun moment Claude Quétel ne remet en cause la culpabilité de Petiot. Quant à la folie, il suggère surtout que Petiot a su duper les médecins, ou non, mais qu'elle était au mieux simulée, sinon intégrée.













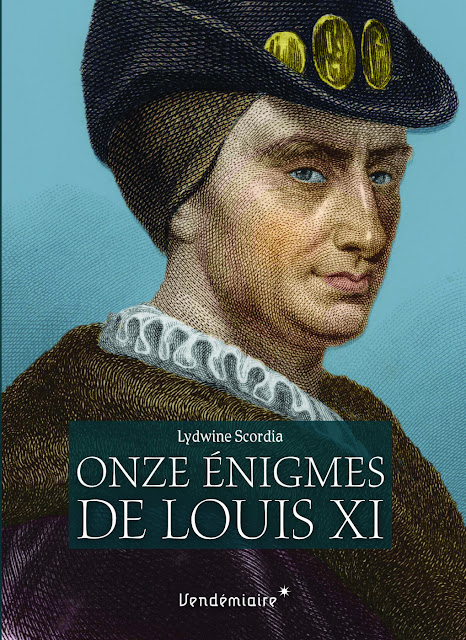



.jpg)
.jpg)
-(April-2023).jpg)

.jpg)







